Les passages préférés : « Trois femmes puissantes » de Marie Ndiaye
Parce que je crois qu’il n’y a, parfois, pas meilleur moyen pour parler d’un livre que de citer ses passages préférés.
J’ai adoré la première et la dernière histoire, la seconde m’a laissé de marbre et je me soupçonne de misandrie sur ce coup-là : pourquoi la seule histoire où le héros est un homme m’a « agacée » ? Je suis restée soufflée par le style de Marie Ndiaye, en particulier sur le premier texte. Quelle écriture ! Mais c’est la dernière héroïne, la dernière femme puissante qui m’a le plus touchée.
« Mais quels mots pouvait-elle trouver, assez précis pour leur faire comprendre le malaise, l’indignation qu’elle avait éprouvés deux ou trois jours auparavant, lors d’une de ces scènes domestiques où s’illustraient si bien à ses yeux la vicieuse déloyauté de Jakob et la médiocrité de pensée dans laquelle elle-même était tombée, alors qu’elle avait tant aspiré à la délicatesse, à la simplicité, alors qu’elle avait si grand-peur des esprits tordus et qu’elle les avait fuis au moindre indice quand elle vivait seule avec Lucie, résolue à ne jamais exposer la petite fille à l’extravagance, à la perversité ? Mais elle avait ignoré que le mal pouvait avoir un regard gentil, qu’il pouvait être accompagné d’une fillette exquise et prodiguer de l’amour – oh, c’est que l’amour de Jakob, impersonnel, inépuisable et vague, ne lui coûtait rien, elle le savait maintenant.
Il y a des gens gentils dont je me méfie comme la peste, comme si leur affection était bien plus toxique que la méchanceté de certains. La vie m’a appris ça.
Car sur son ventre à elle aussi un démon s’était installé. (…) Une onde de rage contre son père la traversa si violemment qu’elle en claqua des dents. Qu’avait-il fait de Sony ? Qu’avait-il fait d’eux tous ? Il était chez lui partout, installé en chacun d’eux en toute impunité et, même mort, continuerait de leur nuire et de les tourmenter
.
« Elle ouvrait de nouveau son esprit aux pâles chimères qui lui tenaient lieu de pensées depuis qu’elle habitait chez ces gens, oubliant, incapable même de se rappeler qu’elle l’avait éprouvée, la peur violente qui l’avait traversée quelques minutes plus tôt à l’idée qu’il lui faudrait s’en aller, non qu’elle eut le moindre désir de rester (elle ne désirait rien) mais parce qu’elle avait senti que ces rêveries ne survivraient pas à un tel changement de sa situation, qu’elle aurait à réfléchir, à entreprendre, à décider ne serait-ce que de la direction où porter ses pas et que, dans l’état de langueur qui était le sien, rien n’était plus terrifiant que cette perspective. »
Si l’on se demande pourquoi certains individus restent auprès de ceux qui les maltraitent, un des clés, c’est ce passage. Parfois, il est plus terrifiant de se décider à partir après s’être réfugié dans une espèce d’apathie « protectrice ». Le mécanisme de défense, de résistance peut se retourner contre soi. Cela peut sembler démentiel de déployer une énergie pour choisir.
« De telle sorte qu’elle avait toujours eu conscience d’être unique en tant que personne et d’une certaine façon indémontrable mais non contestable, qu’on ne pouvait la remplacer,elle Khady Demba, exactement, quand bien même ses parents n’avaient pas voulu d’elle auprès d’eux et sa grand-mère ne l’avait recueillie que par obligation – quand bien même nul être sur terre n’avait besoin ni envie qu’elle soit là. Elle avait été satisfaite d’être Khady, il n’y avait eu nul interstice dubitatif entre elle et l’implacable réalité du personnage de Khady Demba. Il lui était même arrivé de se sentir fière d’être Khady car, avait-elle songé souvent avec éblouissement, les enfants dont la vie semblait joyeuse, qui mangeaient chaque jour leur bonne part de poulet ou de poisson et qui portaient à l’école des vêtements sans taches ni déchirures, ces enfants-là n’étaient pas plus humains que Khady Demba qui n’avait pourtant, elle, qu’une infime partie de bonne vie. A présent encore c’était quelque chose dont elle ne doutait pas – qu’elle était indivisible et et précieuse, et qu’elle ne pouvait être qu’elle-même. «
« Peu lui importait qu’elle ne comptât, elle, pour personne, que nul ne pensât jamais à elle. Elle était tranquille et vivante et jeune encore, elle était elle-même et son corps en pleine santé savourait de toutes ses fibres l’indulgente chaleur du petit matin. (…) »
« De telle sorte qu’elle n’était pas effrayée ni humiliée de se voir assistée par le garçon dans les gestes les plus simples et que ce soutien qu’il lui apportait, ces deux mains qu’il avait entrecroisées afin qu’elle y posât le pied puis qu’il avait élevées vigoureusement pour lui faire atteindre le haut du camion, ne remettait nullement en cause l’idée qu’elle avait maintenant de sa propre indépendance, de son affranchissement d’une quelconque volonté d’autrui la concernant (…).
La résistance. La conscience de soi. Deux choses essentielles.
Et puis j’ai fermé le livre. Sans rien raconter, j’ai fermé le livre en remerciant la providence ou le hasard d’être née en France au XXème siècle, là où être une femme ne suppose pas automatiquement d’être en proie à la folie des hommes…
(Car jamais, jamais, être né garçon ne fut une infortune. Nulle part.)
Et à cette minute même, des humains s’élancent, une échelle de fortune à la main, vers un grillage, vers une barque, vers quoi que ce soit, vers une potentielle liberté. Pour beaucoup d’entre eux, ils s’écrouleront et mourront en murmurant peut-être leur propre prénom : « C’est moi ».
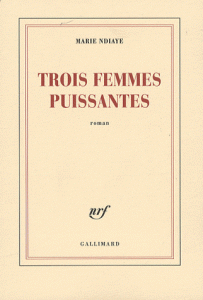
Sensé. Et bien que l’on sent un ressenti presque légitime envers les hommes – du moins, ceux du roman- le propos tend vers le sens, celui de se retrouver dans les femmes libres de Marie Ndiaye. Homme ou femme, nous sommes humains et la résistance contre l’oppression masculine est un combat androgyne : « Nous sommes tous des féministes ».